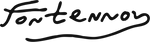L’art brut et la perception du réel : les inspirations derrière la pièce unique « L’Enfant Papillon »
En 2024, ma redécouverte de l’art brut a profondément influencé la création de la pièce unique « L’Enfant Papillon », dévoilée en septembre de la même année. Dans ce nouveau billet, j’ai eu envie de revenir aux sources de cette découverte et aux réflexions qu’elle a pu engendrer.
Mon premier contact avec une pratique artistique non académique, pouvant s’apparenter à l’art brut, remonte à mon adolescence, lors de vacances en bord de mer. La maison où je logeais n’avait rien de remarquable au premier abord : des murs nus, une décoration inexistante… à une exception près.
Dans l’escalier menant au premier étage, de petites peintures carrées étaient soigneusement alignées sur le mur. Ces toiles avaient été peintes, puis offertes au propriétaire des lieux par un interné psychiatrique, qui passait son temps à reproduire maladroitement des œuvres de Mondrian.
Adolescente, ces toiles m’intriguaient. Sans connaître la notion d’art brut, je m’interrogeais sur l’état mental du peintre et sur l’influence possible de celui-ci sur sa pratique artistique. Si, à l’époque, ces questions n’ont pas trouvé de réponses, les fausses toiles de Mondrian ont laissé un souvenir vivace dans mon esprit jusqu’à ma véritable découverte de l’art brut en 2024.
Ce terme, développé par Jean Dubuffet au milieu du XXe siècle, désigne les créations d’artistes évoluant en marge de la société, sans formation académique ni culture artistique au sens classique du terme. Ces créateurs et créatrices appartenaient alors au monde des mystiques, des internés psychiatriques, des criminels ou, plus simplement, à celui des reclus. Si certains considèrent l’art brut comme une tentative de retrouver une forme de création artistique pure, dépourvue de cadres académiques, je le perçois avant tout comme une invitation à interroger autrement notre perception du réel et, surtout, notre définition de la normalité.

Henry Darger et les royaumes de l’irréel.
L’un des fers de lance de l’art brut est Henry Darger, un artiste et écrivain américain ayant vécu au XXe siècle. Grand solitaire, il est marqué par un long séjour dans un hôpital psychiatrique dès l’âge de 13 ans.
L’œuvre phare d’Henry Darger, c’est son récit illustré appelé The Story of the Vivian Girls, in What is Known as the Realms of the Unreal, of the Glandeco-Angelinnian War Storm, Caused by the Child Slave Rebellion. L’ouvrage se compose d’aquarelles, de dessins et de collages représentant les aventures de sept princesses vivant au royaume d’Abbieannia. Confrontées aux machinations du cruel John Manley, les sept princesses luttent pour sauver leur royaume et libérer ses enfants de l’esclavage. Dessinateur autodidacte, Henry Darger recopie, décalque et colorise des images issues de comics américains.
La manière de créer d’Henry Darger m’a beaucoup interpellée, enthousiasmée et aussi rassurée. N’ayant aucune formation académique ni réel apprentissage du dessin, Darger reste un autodidacte qui a trouvé des moyens détournés pour s’exprimer. En tant que créatrice autodidacte, je me pose souvent la question de la légitimité des œuvres qui s’appuient sur des techniques imparfaites et parfois limitées. Je trouve intéressant que l’art brut questionne cette notion de légitimité en rappelant que la création peut s’affranchir de cadres académiques tout en conservant ce qui est réellement fondamental : l’esthétique de la transmission.
Le collier L’Enfant Papillon est un hommage direct à l’œuvre de Darger, puisqu’il s’inspire d’un type de créatures qu’il avait imaginées : les Blenguins. Mi-enfants, mi-papillons, ces êtres hybrides peuplent un univers où la frontière entre l’innocence et l’inquiétant est souvent floue.
Dans mon précédent billet, j’ai parlé de la place que joue l’imaginaire dans mon architecture mentale. Je crois que c’est un fil conducteur important pour moi, qui me vient de mon enfance, et c’est pourquoi l’œuvre d’Henry Darger m’a autant touchée. Son rapport particulier à l’enfance et son souhait de ne jamais grandir suggèrent, pour moi, qu’une frontière très fine entre son œuvre et sa vie s’est construite au fil des années. Si Henry Darger a fini par vieillir, peut-être qu’Abbieannia représente son Pays Imaginaire, peuplé d’enfants perdus, et que sa pensée y subsiste, éternellement jeune.

Séraphine de Senlis et Else Blankenhorn : entre ferveur végétale et solitude.
Séraphine Louis, dite de Senlis, est née en 1864 dans l’Oise. Issue d’un milieu modeste, elle devient orpheline à sept ans avant d’être recueillie par sa sœur aînée. Élevée à la campagne, elle développe un lien profond avec la nature, s’adressant aux plantes et aux arbres comme à des êtres vivants. Sa ferveur religieuse, omniprésente dans son existence, est aussi à l’origine de ses visions mystiques. L’une d’elles lui aurait révélé, sous les traits d’un ange, qu’elle était la « fleuriste de la Vierge » et qu’elle devait consacrer sa vie à la peinture. Si elle sombre dans la folie à partir des années 1930, son œuvre ne se résume pas à cela. Comme l’explique Giordana Charuty, Séraphine a laissé derrière elle des peintures vibrantes, peuplées de « fleurs tourmentées et d’arbres de paradis », à travers lesquelles elle transmet non seulement sa ferveur religieuse, mais aussi la solitude inhérente à sa condition de femme.
Ce sentiment de solitude se retrouve également chez une autre artiste de l’art brut, Else Blankenhorn, née en 1873 en Allemagne. Brodeuse, musicienne, chanteuse, traductrice et compositrice, Else passe une bonne partie de sa vie dans des sanatoriums. Persuadée d’être l’épouse spirituelle de l’empereur prussien Guillaume II, elle consacre une partie de son travail à la réalisation d’une monnaie destinée à financer un mystérieux projet porté par son époux fictif : la « résurrection des couples amoureux ». Les billets de banque, peints à l’encre bleue, représentent des figures féminines hybrides, entre harpies et anges.

L’art brut : arpenter et transmettre nos univers intérieurs.
Henry Darger, Séraphine de Senlis et Else Blankenhorn semblent tous avoir évolué dans des mondes impalpables, oscillant entre le mystique, le rêve et le cauchemar. Pourtant, je crois qu’il serait trop facile de réduire leurs créations à de simples manifestations de folie.
Si l’art brut a trouvé un tel écho en moi, c’est aussi pour des raisons un peu plus personnelles. En avril 2024, ma grand-mère a parlé, pour la première fois, de ses hallucinations. Son quotidien s’est peu à peu peuplé d’enfants turbulents, de formes spectrales et de sœurs oubliées.
Si ma grand-mère n’a aucune pratique artistique, j’ai le sentiment que ses visions traduisent, à l’instar des artistes évoqués plus tôt, une profonde solitude et un rapport difficile à la vie. J’aime à penser que ces architectures mentales, loin de reposer sur l’irrationnel, s’appuient sur des réalités et des fragilités personnelles concrètes. C’est ce que suggère Else Blankenhorn en affirmant : « La vie de la pensée est, après tout, bien réelle. ». C’est une idée rassurante, car elle suggère qu’il subsiste toujours des fragments de beau et de tangible, même dans les espaces les plus oniriques et fantasmés. Elle est d’autant plus réconfortante qu’elle accompagne, selon moi, la possibilité d’établir des liens de compréhension entre différentes visions de la réalité.
Ces liens, je les retrouve dans ma propre pratique, qui se résume à explorer mes univers intérieurs pour les traduire sous forme de bijoux ou d’objets dans un souci de transmission et de catharsis. Chaque pièce et chaque collection me ramènent à un état d’esprit, à des sources d’inspiration et à des souvenirs particuliers qui, à terme, forment une grande toile de ce qui m’anime au quotidien. Si l’on peut facilement fantasmer l’art brut et oublier qu’une partie des artistes qui peuplent ce courant se sont réellement perdus dans leurs réalités, j’y vois pour ma part un rappel qu’au-delà des visions mystiques, des amours imaginaires et des royaumes enchantés, il reste toujours l’envie de transmettre ce qui peuple notre vie intérieure.
Découvrir le médaillon L'Enfant Papillon ↗